La politique symbolique
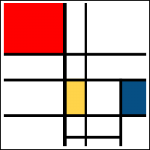 Avant même d’aborder la question « pour ou contre les défilés militaires le 14 juillet ? » et de prendre parti pour l’un ou l’autre camp, avant même de suspecter les abolitionnistes de l’exhibition belliqueuse juillettiste d’inculture et des les exhorter à reprendre les routes conduisant vers leur septentrion supposé originaire, avant même de qualifier de xénophobe et pétainiste la réaction face à l’audace pacifiste s’autoproclamant seule détentrice du monopole du Civisme et des Valeurs Républicaines, il convient de remarquer une chose.
Avant même d’aborder la question « pour ou contre les défilés militaires le 14 juillet ? » et de prendre parti pour l’un ou l’autre camp, avant même de suspecter les abolitionnistes de l’exhibition belliqueuse juillettiste d’inculture et des les exhorter à reprendre les routes conduisant vers leur septentrion supposé originaire, avant même de qualifier de xénophobe et pétainiste la réaction face à l’audace pacifiste s’autoproclamant seule détentrice du monopole du Civisme et des Valeurs Républicaines, il convient de remarquer une chose.
Cette question des défilés ressort du symbole. Tant d’autres problèmes, tant d’autres questions, tant d’autres urgences économiques, sociales, politiques qui ne sont non pas formelles, non pas abstraites, mais concrètes et réelles — mais non : on juge d’un côté que le plus crucial est la couleur du costume, de l’autre qu’il y a grand péril à vouloir en changer. Dans ce débat, par-delà les antagonismes radicaux des positions qui font la France se couper en deux comme jamais depuis l’affaire Dreyfus, il y a un présupposé commun : que cette question est importante, de premier ordre, un enjeu majeur nécessitant même que l’on s’insulte.
Lorsqu’une politique pose que les questions symboliques sont celles dont il faut s’occuper en premier lieu, il y a tout lieu de penser que cette politique n’est en elle-même rien d’autre que symbolique. C’était déjà le cas avec les fumeux débats quant à l’identité nationale ou la double nationalité ; et l’on constate aujourd’hui que la droite n’est pas la seule productrice de politique symbolique : en soulevant ces questions, l’opposition (au moins l’une de ses parties) se montre apte à rivaliser en agitant tout aussi bien le spectre fantomatique des valeurs — sans doute la meilleure preuve qu’elle est capable de gouverner au moins aussi mal.
Tout comme le signe, le symbole renvoie à autre chose qu’à lui-même. En tant que signe, le mot que j’écris n’a qu’une autonomie limitée : détaché du sens, de la signification et des idées auxquels il renvoie, son existence n’est que très précaire. Le symbole, en revanche, peut continuer d’exister indépendamment de ce à quoi il fait référence. Un tableau peut utiliser un lion pour symboliser la force et un renard pour la ruse ; l’ignorance du code de traduction — tantôt tacite, tantôt explicite — n’en invalide pas pour autant la signification prise au premier degré figurant le lion et le renard. Les allégories de la peinture classique ou médiévale, dont les renvois étaient pour tous évidents il y a quelques siècles, sont aujourd’hui souvent ignorés et les tableaux considérés non plus pour ce à quoi ils renvoient, mais simplement pour ce qu’ils figurent, de sorte que l’expérience esthétique face à eux est en ce sens proche de celle qui advient face à l’art abstrait.
De même, ce dont traite la politique symbolique — le symbole — prend le risque de se détacher de ce réel dont elle prétend pourtant parler ; elle court le risque de prendre son autonomie vis-à-vis du monde en s’envolant telle une colombe dans le ciel des abstractions, pour ne devenir qu’une vaine tautologie où elle ne finit par ne parler plus que d’elle-même dans un élan autistique à coup de truismes, où à l’écho de la vallée de gauche ne répond plus que l’écho de la vallée de droite. L’abstraction est un danger du symbolisme, où les symboles peuvent ne plus avoir qu’une fonction immanente à la représentation, une existence qu’au premier degré. La politique symbolique est peut-être aussi élégante et harmonieuse que Les bergers d’Arcadie, mais elle renvoie à aussi peu de choses que ce à quoi renvoie un tableau de Mondrian : la politique symbolique ne transcende pas.
| Pour approfondir, ce produit disponible chez un libraire de proximité, éthique, responsable, durable et équitable : |

17 août 2011 à 16:02 Octavius[Citer] [Répondre]
J’entends parfaitement vos arguments, mais il me semble que l’intérêt majeur du symbole (dès lors qu’il est politique) est de faire lien. Dans la mesure où le symbole est partagé, il fait ciment. Et c’est parce que, précisément, le 14 juillet (comme symbole) n’est ni de gauche, ni de droite qu’il est concret. Concret comme le peuple l’est. Et quant aux récupérations, elles sont si grossièrement malhonnêtes…
21 septembre 2011 à 9:08 Oscar Gnouros[Citer] [Répondre]
Pardon, je réponds tard. Je n’ose l’avouer, mais le scepticisme qui me pousse à me méfier du symbolisme politique est sans doute un arrière-fond de nietzschéo-stirnerisme, qui me conduit à assimiler peut-être un peu trop rapidement tout discours de ce type à un reflux des arrières-mondes empêchant l’homme de pouvoir marcher sur ses deux jambes comme un adulte. Mais effectivement, peut-être la société a-t-elle besoin de symbole quoi qu’il en soit, et la question est alors avant tout celle de leur usage légitime. Sur ce point, on retombe sur un enjeux de ce post : qu’il faudrait se méfier d’une politique qui s’y cantonnerait en raison des dangers décrits.