Coquineries philosophiques : comment séduire et être séduit
Lecteur de Morbleu, bonne année à toi ! Puisqu’il est d’usage de faire des vœux, je te souhaite une bonne santé, beaucoup de lectures passionnantes sur ce blog fabuleux et surtout, le plus important, de l’amour. Séduis, sois séduit, aime et jouis, et carpe diem. Tu me diras que c’est facile à dire, ou au contraire bien inutile de ton côté. Mais la séduction n’est pas une mince affaire ; quant à la jouissance, n’est-ce pas un peu déplacé d’en parler ainsi tout de go ? Que nenni, car la séduction et la jouissance dont je voudrais te parler aujourd’hui n’ont rien à voir avec la drague balourde des night clubs ou la consommation brutale des corps. Plaisir, jouissance, séduction, tout cela requiert bien plus qu’un simple déballage physique, comme le démontrent Roland Barthes et Jean Baudrillard. Allez, hop, en route pour une petite immersion dans leurs analyses, histoire de commencer l’année du bon pied !
1. Barthes, ou l’art de la perversion
Commençons à rebours, par la jouissance, car il faut d’abord y voir clair dans les sentiments esthétiques pour ensuite mieux cerner la manière dont on cherche à les susciter chez autrui. Premier point : la jouissance n’est pas simplement une intensification du plaisir,

La lectrice de roman, Van Gogh, 1888
un degré supérieur de stimulation des sens, qu’ils soient physiques ou intellectuels d’ailleurs. La jouissance est un état bien différent d’une hystérie des sens, et elle se distingue nettement du plaisir. Barthes, dans son opuscule Le plaisir du texte, essaye de saisir ce qui fait la différence entre un texte qui procure du plaisir et un texte dont on jouit, en travaillant à partir de l’approche du lecteur. Car on pense qu’un texte qui procure du plaisir a été écrit dans le plaisir ; la réciproque n’est pas pour autant vraie, car écrire dans le plaisir ne garantit en rien le plaisir qu’en tirera le lecteur. Barthes lâche alors le vilain mot : il faut draguer le lecteur.
Mais c’est là, dans cette volonté de séduction, que s’ouvre l’espace de la jouissance : « Ce n’est pas la « personne » de l’autre qui m’est nécessaire, c’est l’espace : la possibilité d’une dialectique du désir, d’une imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu ». Et déjà se prépare ce qui va s’affirmer plus loin dans cet opuscule comme la différence essentielle entre plaisir et jouissance : la jouissance déborde, échappe, laisse du jeu au sens aussi bien mécanique que ludique. Quelque chose bouge, vacille, laisse une petite place pour l’incertitude et le déséquilibre, pour l’improvisation et surtout, surtout, pour la réaction du lecteur.
Barthes ne parvient pas encore ici, dans ces toutes premières pages de son travail, à distinguer plaisir et jouissance du texte. Mais il prend alors des œuvres comme objets, et les scrute au microscope de l’analyse littéraire. Et là, l’œil perçoit des ruptures, des contacts, des surimpressions au sein des textes, qui sont justement les lieux d’où émerge le plaisir du lecteur. Tout commence avec Sade bien sûr, où Barthes identifie deux bords de la langue : l’un, « sage, conforme, plagiaire », et l’autre « mobile, vide (apte à prendre n’importe quels contours), qui n’est jamais que le lieu de son effet : là où s’entrevoit la mort du langage ». Oh le coquin ! Car c’est dans l’espace du mouvement que s’entrevoit une petite mort : la perte de soi, la destruction du langage, quand les mots manquent et que seule demeure la jouissance de cet arrêt soudain. Comme lorsque le libertin fait couper la corde qui le pend au moment où il jouit.
Désir, mort : oui, la jouissance est névrotique, mais la névrose n’est pas un simple excès, elle est bien un conflit. Ce conflit, dans le texte, c’est celui des deux bords du texte, de 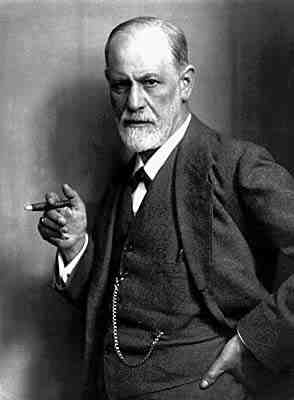 la faille qui s’installe entre eux mais dont le sujet reste parfaitement conscient. Dès lors on peut distinguer deux régimes de lecture : l’une appliquée, presque myope, qui suit le texte à la lettre, et l’autre empressée, bondissante, qui saute les jeux de langage pour aller tout de suite aux articulations. L’une et l’autre ne conviennent pas aux mêmes textes, mais toujours, c’est lorsqu’elles entrent en collusion que se produit pour le lecteur la déperdition de la jouissance.
la faille qui s’installe entre eux mais dont le sujet reste parfaitement conscient. Dès lors on peut distinguer deux régimes de lecture : l’une appliquée, presque myope, qui suit le texte à la lettre, et l’autre empressée, bondissante, qui saute les jeux de langage pour aller tout de suite aux articulations. L’une et l’autre ne conviennent pas aux mêmes textes, mais toujours, c’est lorsqu’elles entrent en collusion que se produit pour le lecteur la déperdition de la jouissance.
Barthes saisit alors la grande différence entre plaisir et jouissance, et je vous retranscris ce paragraphe qui dit tout :
« Texte de plaisir : celui qui contente, emplit, donne de l’euphorie ; celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui déconforte (peut-être jusqu’à un certain ennui), fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques, du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise sont rapport au langage.
Or c’est un sujet anachronique, celui qui tient les deux textes dans son champ et dans sa main les rênes du plaisir et de la jouissance, car il participe en même temps et contradictoirement à l’hédonisme profond de toute culture (qui entre en lui paisiblement sous le couvert d’un art de vivre dont font partie les livres anciens) et à la destruction de cette culture : il jouit de la consistance de son moi (c’est son plaisir) et recherche sa perte (c’est sa jouissance). C’est un sujet deux fois clivé, deux fois pervers ». [1]
2. La guerre des mondes
Barthes confirme que la jouissance ne se distingue pas du plaisir par une simple question de degré, car alors leur relation serait pacifiée et relèverait de l’idée bien historique de progrès. Mais cela signifierait que le lecteur qui prend du plaisir n’a pas encore atteint la lecture de jouissance, ou que l’écrivain qui donne du plaisir n’a pas encore atteint le sommet de son art. Pourtant la jouissance n’est pas snob, elle peut apparaître au détour d’une page. Plaisir et jouissance sont plutôt « des forces parallèles », qui s’affrontent et se distinguent toujours, et la seconde ne surgit donc jamais que comme un scandale. Quel scandale ? Celui de l’épuisement du langage, de la destruction du sociolecte, du parler social, de l’idéologie dominante.
D’où deux idées : la jouissance n’est jamais une prise, elle est au contraire une perte, et c’est en cela qu’elle relève de l’indicible et de l’imprévisible ; secundo, Barthes la pense impossible dans une culture de masse. Car la culture de masse est petite-bourgeoise, et elle est donc bien sûr idéologique, mais surtout la jouissance est asociale car elle brise les codes usuels du plaisir et du langage. Est-ce là de l’élitisme ? Oui et non : car si l’on consomme les textes de la culture de masse, alors on est cloué au plaisir – et encore… mais c’est une autre question. Mais n’importe qui peut s’emparer d’une œuvre de jouissance, la lire et en éprouver le délicieux chambardement. Il faut seulement accepter de sortir des grands repères culturels en vigueur, oser se frotter à la littérature, quitter les habitus confortables, abandonner la langue connue, prendre le risque de s’égarer.
« Textes de jouissance. Le plaisir en pièces ; la langue en pièces ; la culture en pièces ». Et même, sujet en pièce, car le texte est un tissu sans cesse travaillé, dans lequel le sujet se défait « telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile ». Le sujet qui prend du plaisir à un texte se retrouve, se reconnaît, il navigue dans une neutralité bienveillante où les codes et les repères habituels sont bien indiqués. Mais le sujet qui jouit, il meurt à lui-même, il se liquéfie dans une toile dont la structure lui échappe, car elle aura changé de configuration à la prochaine lecture. Folie de la jouissance !
Il y a donc ce qui procure du plaisir : la linéarité, la clarté, la fluidité, je dirais même l’aspect apollinien des œuvres et des choses. Le plaisir se développe en souplesse, dans le confort ouaté d’une compréhension immédiate des idées, des formes, des sensations : il est  l’harmonie sensorielle de notre corps et de notre esprit, une sorte de bulle apaisante où nulle tension ne menace. Et il y a, non pas au-dessus ou après le plaisir, mais bien à côté, en dehors, ailleurs que lui, ce qui provoque la jouissance : la tension, la rupture, la hachure, l’implicite, la confusion. Le plaisir pointe et s’épanouit dans une progression douce, on le reconnaît, on l’apprivoise, on le domestique ; la jouissance éclate brutalement, elle nous possède et nous transporte. Mais ne croyons pas qu’elle n’est qu’un éclair, aussi instantané qu’un sursaut : car elle a aussi ce don secret de pouvoir se maintenir, en faisant vibrer les cordes de notre sensibilité sans que l’on puisse jamais prévoir laquelle elle choisira. Elle est une suspension qui menace toujours de s’écrouler, mais sans jamais maintenir le même point d’équilibre.
l’harmonie sensorielle de notre corps et de notre esprit, une sorte de bulle apaisante où nulle tension ne menace. Et il y a, non pas au-dessus ou après le plaisir, mais bien à côté, en dehors, ailleurs que lui, ce qui provoque la jouissance : la tension, la rupture, la hachure, l’implicite, la confusion. Le plaisir pointe et s’épanouit dans une progression douce, on le reconnaît, on l’apprivoise, on le domestique ; la jouissance éclate brutalement, elle nous possède et nous transporte. Mais ne croyons pas qu’elle n’est qu’un éclair, aussi instantané qu’un sursaut : car elle a aussi ce don secret de pouvoir se maintenir, en faisant vibrer les cordes de notre sensibilité sans que l’on puisse jamais prévoir laquelle elle choisira. Elle est une suspension qui menace toujours de s’écrouler, mais sans jamais maintenir le même point d’équilibre.

L'extase de Sainte Thérèse, Le Bernin, 1652
Jouir, c’est donc être en danger : en danger de ne pas comprendre, de ne plus suivre le « fil » de l’histoire, de s’égarer, de confondre ses sentiments, ses idées et ses perceptions, de sauter des pages, de mal regarder ou de mal écouter, de mal embrasser. Le jouisseur n’est pas un ogre glouton qui accumule les plaisirs ; c’est quelqu’un qui, l’instant d’avant, ne savait pas qu’il allait jouir de ce qu’il découvre. Et même, il est peut-être faux de parler de jouisseurs : la jouissance n’est pas une quête, un idéal ou un mode de vie, elle est un accident des sens, une déperdition de soi que l’on ne saurait jamais programmer sans la manquer.
La jouissance apparaît ainsi lorsqu’on quitte le chemin balisé du plaisir, lorsqu’on est détourné de ses attentes et de ses préférences… Lorsqu’on est séduit. Seduco, ere, emmener à l’écart, détourner, tirer du chemin. Et ce qui nous séduit, c’est encore une affaire de décrochage, de confusion, d’inversion.
3. Baudrillard, la reine de la drague
Ici c’est Baudrillard qui nous parle, dans son ouvrage De la séduction, d’érotisme, d’amour, de désir, dans une approche qui résonne bien familièrement avec ce que nous venons de dire de la jouissance. Barthes disait, dans Le plaisir du texte, que l’endroit le plus érotique d’un corps est « là où le vêtement bâille », dans l’intermittence « de la peau qui scintille entre deux pièces (le pantalon et le tricot), entre deux bords (la chemise entrouverte, le gant et la manche) ; c’est ce scintillement même qui séduit, ou encore : la mise en scène d’une apparition-disparition ». C’est avec cette analogie érotique que Barthes progressait dans la saisie de l’idée de jouissance du texte, et bien sûr séduction et jouissance vont de pair. Baudrillard poursuit cette approche de l’érotisme, cette fois au niveau des corps, en analysant le processus de la séduction ; la séduction qui seule peut procurer, non pas le simple plaisir des yeux – car le plaisir peut bien survenir même si l’on n’est pas séduit, cela s’appelle le voyeurisme -, mais la véritable jouissance amoureuse.
Car la séduction est avant tout de l’ordre de l’artifice, du signe et du rituel ; d’après Baudrillard l’ère bourgeoise, toute entière tournée vers la nature et la production, y a mis fin en imposant l’ordre et la technique comme idéaux. On note ici l’accusation commune à Barthes et Baudrillard contre l’idéologie bourgeoise, meurtrière grossière et sans élégance de la jouissance et de la séduction [2]. Mais la séduction se maintient, ne peut que se maintenir, car elle est la subversion du masculin par le féminin. Bon, ici on entre dans une interprétation psychanalytique de la sexualité : il n’y a qu’une seule libido, et elle est masculine. C’est le pouvoir, la force, la détermination, c’est le phallus quoi. Mais à cette libido se superpose, plus qu’elle ne s’oppose, une autre force : celle du féminin qui est toute entière profondeur, apparence, indétermination. Profondeur et apparence ? Oui, le féminin est profondeur car il absorbe les efforts du masculin et se l’approprie, physiquement et symboliquement ; apparence, car là où le masculin est clair, lisible, déterminé et inscrit dans le réel, le féminin est subversion, confusion, chaos, symbole [3].

Ulysse et les sirènes, Herbert James Draper, 1909
Où est la séduction, dans tout cela ? Elle consiste précisément dans ce que Baudrillard appelle la « réversibilité séductrice », dans la réversion des signes, des forces, des niveaux. Dans l’absorption du masculin par le féminin qui brouille les codes, les apparences, le sens du réel pour en faire du symbolique. La séduction du coup est transsexuelle : en elle, le féminin ne saurait jamais constituer un terme marqué, ni un terme non marqué d’ailleurs, puisqu’il est oscille sans cesse entre les significations. C’est d’ailleurs pour cela que la séduction a presque toujours été rejetée comme un détournement artificiel de la vérité ; mais c’est pour la même raison que Baudrillard lutte pour sa reconnaissance, car d’après lui c’est le privilège du féminin de n’avoir jamais accédé à la vérité, dans sa clarté, son évidence, sa lisibilité, mais d’être au contraire restée le maître absolu des apparences. La séduction dépouille le féminin de toute vérité, et la ramène à sa dimension essentielle : le pur jeu des apparences. Ici encore du jeu ! Du mouvement, de l’espace pour l’indétermination, comme dans la jouissance barthienne.
Est-ce à dire que la séduction est insaisissable ? Bien sûr que non, nous l’avons tous éprouvée une fois : elle est une « évidence fulgurante », « elle est immédiatement là, dans le retournement de toute profondeur prétendue du réel, de toute psychologie, de toute anatomie, de toute vérité, de tout pouvoir ». La séduction n’a en propre aucun pouvoir, mais elle réversibilise tous les signes des pouvoirs qu’elle croise, et ainsi se les soumet. Elle repose sur cette capacité qu’a le féminin de confondre l’authentique et l’artificiel, la surface et la profondeur, et de faire vaciller les pôles sexuels. Elle joue sur l’incertitude, sur la faille, sur l’indétermination qui s’installe entre les signes, les repères usuels, les registres d’expression – bref, sur le décrochage, l’inconfort, le tâtonnement. La véritable séduction est ainsi déjà

Priscilla, folle du désert, 1994
source de jouissance, pour peu que l’on se prête à son jeu troublant. Et ce n’est pas là chose aisée, car la séduction dont nous parle Baudrillard n’est pas la drague, la chasse sexuelle, la quasi-pornographie que les mauvais films ou les romans à l’eau de rose proposent au consommateur. La véritable séduction est dans la réversion des signes et des apparences : dans le transvestisme.
Et oui ! Le transvestisme serait le paradigme de la séduction, car il produit une « vacillation sexuelle », bien différente de la simple attraction d’un sexe sur l’autre. Il est un jeu de signes, où les signes sont inversés, chamboulés, surjoués, et eux-mêmes séduits. Quoi de plus séduisant qu’un transsexuel, un travesti, une drag-queen ? Car ce sont eux/elles qui attrapent le regard, qui nous font tourner la tête dans la rue, qui capturent l’attention et jouent de nos émotions – moquerie, rejet, intérêt, plaisir, dégoût, fascination et j’en passe. C’est cette surcharge de signes sexuels, leur réversion en une parodie sensuelle qui détourne du chemin de la bienséance et de la reproduction et ainsi, séduit.
Nul lien avec la beauté ici : « La séduction est toujours plus singulière et plus sublime que le sexe, et c’est à elle que nous accordons le plus de prix ». Lecteur, tu penses sans doute déjà ici à la fille aux yeux louches de Descartes, et tu as raison. Séduire, c’est faire loucher les signes sexuels, en jouer, les jeter dans une collusion totalement artificielle qui seule peut mener à la perfection – car la perfection n’est jamais naturelle ou authentique, elle est toute artificielle. Ainsi « tout se joue dans le vertige de cette réversion, de cette transsubstantiation du sexe dans les signes qui est le secret de toute séduction ».
4. Perversion, réversion, imagination [4]
 Baudrillard parle ensuite de jouissance, mais en un sens différent de celui que nous avons exploré avec Barthes ; la jouissance qu’il critique suite à cette analyse de la séduction, c’est celle de la libération sexuelle, celle qui fait l’objet d’une quête éperdue, d’une revendication agressive. Il faut jouir ! C’est le mot d’ordre du porno : « Plus d’incertitude, plus de secret. C’est l’obscénité radicale qui commence ». La jouissance est l’usufruit industriel des corps, à l’opposé de toute séduction : « Celle-ci est un jeu, le sexe une fonction. La séduction est de l’ordre du rituel, le sexe et le désir sont de l’ordre du naturel ».
Baudrillard parle ensuite de jouissance, mais en un sens différent de celui que nous avons exploré avec Barthes ; la jouissance qu’il critique suite à cette analyse de la séduction, c’est celle de la libération sexuelle, celle qui fait l’objet d’une quête éperdue, d’une revendication agressive. Il faut jouir ! C’est le mot d’ordre du porno : « Plus d’incertitude, plus de secret. C’est l’obscénité radicale qui commence ». La jouissance est l’usufruit industriel des corps, à l’opposé de toute séduction : « Celle-ci est un jeu, le sexe une fonction. La séduction est de l’ordre du rituel, le sexe et le désir sont de l’ordre du naturel ».
Pourtant, il me semble que ce que dit Baudrillard de la séduction entre en résonance avec ce que nous dit Barthes de la jouissance – à condition de bien maintenir cette dernière notion dans la sphère esthétique. Il ne faut pas confondre la jouissance esthétique avec la jouissance orgasmique vendue par la pseudo-libération sexuelle, qui n’est pour Baudrillard que le placage brutal et industriel de l’ordre naturalisant bourgeois sur l’incertitude et l’artifice de la séduction ; cette dernière n’a de jouissance que le nom. Jouir, c’est être séduit, se perdre, quitter le confort des signes bien connus pour plonger dans un inconnu troublant et en mouvement. C’est jouer, accepter l’ironie, la surcharge, l’excès, le désordre, bref, l’artifice. Autrement dit, on ne peut pas jouir ou être séduit par des diktats ; cela va sans doute de soi, mais si l’on tire l’analyse un peu plus loin, alors on ne peut jouir ou être séduit que par ce qui bouscule les signes, les habitudes, les repères culturels.
Vous me direz, « oui, bien, tout cela est gentil, mais ne vivons-nous pas une époque de perpétuel bouleversement des codes, des signes, des repères culturels ? Voyez la mode, la sexualité, la world-culture d’aujourd’hui : la postmodernité n’est-elle pas essentiellement jouissance et séduction ? ». Et bien je crois que non. On peut bien sûr y trouver de la séduction et de la jouissance ; simplement, celles-ci se refusent à l’ordre, à la prévision, à la programmation. Elles sont toujours dans l’intervalle, dans la confusion, dans la réversion du réel : et la réversion n’est pas l’inversion ou la subversion.
Inverser, c’est facile ; subvertir, les publicitaires, les agences de mode, les producteurs et l’industrie toute entière ne font que cela, dans une perpétuelle quête du choc voyeuriste, de l’irrévérence, de la transformation de « ce-qui-se-faisait-déjà ». Mais la réversion, c’est une percée de l’incertitude et du symbolique dans la détermination du réel : c’est de l’imaginaire bien sûr ! L’hédoniste, le philistin, le libertin ne sont ni des séducteurs ni des jouisseurs, car ils n’imaginent rien et ne laissent aucun doute sur leurs intentions [5] : ils montrent, regardent, consomment, mais celui qui est séduit et qui jouit, c’est celui qui entre dans l’imaginaire des signes. Qui rêve et fantasme, qui ne cherche pas à découvrir une quelconque vérité mais accepte de se maintenir sur la faille, dans l’incertitude et le jeu infini des apparences.
Platon faisait de l’amour l’accès suprême au Vrai, à condition qu’il s’arrache aux apparences justement et se convertisse en quelque sorte au Beau et au Bon : erreur fatale ! L’éros ne peut mener qu’à lui-même et sa réversibilité, car il est l’autre du vrai : non pas qu’il l’empêche ou le détruise, mais il ne peut s’épanouir que si la vérité est brouillée, incertaine, tenue à distance. La vérité n’est pas sexy, elle est trop claire, trop lisible, trop entière. Mais attention, cela ne signifie pas que la séduction et la jouissance passent par le mensonge ! [6] La duplicité, la réversion des signes, le jeu des apparences, tout cela relève du flou artistique, du soyeux d’un drapé qui glisse légèrement, de l’hésitation ; du doute, simplement. Séduction et jouissance appartiennent au règne des indéterminés ; et comme disait Mulder, la vérité, elle, est ailleurs.
_______________________
[1] Là, je ne peux m’empêcher de penser à Giorgio Agamben et son approche du contemporain : la contemporanéité est un espace anachronique, qui se sépare de son temps pour en lire les ténèbres, et pour tisser des ponts éphémères avec d’autres temps, dans un déphasage et un kairos sans cesse en mouvement. Le contemporain crée de la jouissance, il la cherche, il veut se décoller de son époque pour en bousculer les codes et en faire vaciller l’assise : la mode en est peut-être le meilleur exemple, selon Agamben. Bref, ce n’était qu’une allusion possible, revenons-en à Barthes.
[2] Ce que l’on retrouve encore chez Walter Benjamin, Hannah Arendt ou Heidegger, peut-être en mieux d’ailleurs ; mais Baudrillard a cet intérêt de penser les corps dans leur dimension érotique et charnelle, là où les autres penseurs de la modernité s’attachent plutôt aux artefacts de l’art ou de la technique.
[3] Bon, je n’aime pas du tout ces distinctions psychologico-machisto-sexuelles, mais je suis la lettre du texte et la pensée de l’auteur. Néanmoins je le dis : ça me hérisse. Il faudra peut-être un papier là-dessus, à l’occasion.
[4] Ça sonne mieux que les titres des Twilight, hein ?
[5] Sauf pour les libertins de talent, car il y a des séducteurs de haut vol qui, justement, sont doués pour l’incertitude, l’indétermination et la suggestion. Oui, peut-être que la séduction est l’objet d’une manipulation, parfois ?
[6] Oups, rechute kantienne !
| Pour approfondir, ce produit disponible chez un libraire de proximité, éthique, responsable, durable et équitable : |

18 janvier 2013 à 12:18 Luccio[Citer] [Répondre]
Salut Muskette !
Quelle formidable injection de concepts. Merci beaucoup.
Mais il me faudrait quelques exemples pour être sûr que j’ai bien tout compris, et comme je suis paresseux je t’en propose de mon cru.
Commençons par les deux premières parties de ton texte, sur la jouissance et le plaisir selon Barthes. Voici des remarques éparses, un commentaire, comme à mon accoutumée, court et synthétique :-).
1) Il me semble que la jouissance consiste en une certaine surprise, en une bonne surprise. Quand je jouis d’un bon livre je me plais à être constamment surpris par des passages pourtant brillants et logiques, mais inattendus et nourrissant ma réflexion (bonne surprise, agréable surprise).
La surprise peut sans doute être intellectuelle (intelligence — lecture d’une œuvre traduite) ou sensible (style — appréciation d’un truc en français), mais j’ai du mal à trouver des exemples où j’ai l’un sans l’autre.
Tu rappelles la distinction entre jouissance et plaisir, mais on peut aussi imaginer une jouissance dans l’inconfort. Ca me rappelle mes deux lectures de L’Oeil et l’esprit de Merleau-Ponty. Deux lectures inconfortables, où je n’ai pas tout compris, mais très enthousiasmantes, et enrichissant beaucoup ma réflexion.
2)Sinon, après cette remarque un peu perso, je propose une série de trois oppositions (basées sur la surprise) :
– jouissance Vs plaisir
– Les Sopranos Vs Columbo
– Lautréamont Vs Sherlock Holmmes
a) T’as vu, je mets la jouissance contre le plaisir, car il me semble que pour Barthes le jouissance surprend celui qui au fond cherche le plaisir (ce que tu me sembles dire quand tu remarques qu’il n’y a, à proprement parler, pas de jouisseur).
b) A gauche la jouissance (eh oui, moi j’ai pas peur, j’estime les Sopranos, très bonne série tv de masse), accompagnée d’un certain mal-être, de l’autre le plaisir et le confort, qui n’empêchent pas une certaine intelligence. Voilà des exemples qui me paraissent correspondre au texte.
c) Mais les œuvres de gauche, si elles permettent la jouissance, cessent à un moment de surprendre. Et le spécialiste peut avoir un peu de plaisir-confort à les lire.
Cela me le fait (un peu) avec Les Champs de Maldoror de Lautréamont.
Etape 1 : Maldoror voit quelque chose que nous ne voyons pas, engoncés dans nos habitudes que nous sommes ; on se dit qu’il voit la vérité (qui nous échappe).
Etape 2 : A un moment il part en couille (très vite) ; et si on a un peu de recul et dépassé le romantisme (je connais un métaphysicien baudelairien qui me dirait que je suis un con misérable, mais m’offrirait quand même des bières alors que je le traiterais de fou), on voit qu’il ne dit rien de vrai, mais quelque chose de délirant ; avec cette possibilité de dire qu’il sait voir la partie maléfique du monde (mais je maintiens qu’il ne faut pas croire qu’il dit LE vrai — surtout que LE vrai c’est pas son truc)
Etape 3 : jusque là on a du plaisir, on reconnait son bonhomme quand on est habitué
Etape 4 : il est vraiment dans l’ignoble, on a beaucoup de déplaisir, mais on jouit du texte (ce n’est pas sa folie qui nous distrait, c’est le texte dont on jouit).
c) Ce décalage entre l’étape 4 et les étapes précédentes me rend la distinction de Barthes judicieuse. Et même ça permet de voir que l’homme de culture est homme de plaisir (il ramène tout ce qu’il lit, voit, visite, à des choses qu’il connait, est le plus propre à être surpris), pourtant lui qui fréquente les grandes œuvres jouit plus que les autres. On devine bien le problème de l’élitisme du propos. Barthes pourrait se défendre d’élitisime en soulignant que le texte jouissif l’est même pour quelqu’un de pas très cultivé (ce qui est en fait mon cas en littérature, et celui de bien des gens à qui j’ai pu montrer des chants de Maldoror assez hardcore).
Du coup la force serait dans le texte, dans l’œuvre, et non dans le sujet qui la perçoit. Voilà qui permettrait à Barthes de ne pas être élitiste dans l’absolu (ça et le fait d’écrire un jour en français, mais j’ai moi-même du mal, je n’insisterai donc pas).
On voit aussi qu’une œuvre de plus d’une page peut produire plaisir et jouissance, et c’est bon de s’en rappeler.
3) Cependant Barthes s’interdit de penser l’intelligence dans les œuvres de masse, comme Les Sopranos (oui j’insiste). Sans doute ne connaissait-il pas les séries tv (forcément de masses, vu le financement) jouissives (Les 5 dernières minutes devaient lui donner un certain plaisir) .
a) Cela parce qu’il ne peut pas imaginer que la jouissance de l’œuvre soit produite par un auteur. En effet il suppose que la jouissance est associée à une œuvre fuit d’un travail incessant, de telle sorte que son créateur n’a plus d’unité parfaite, et l’œuvre n’est pas son bébé. Elle est un bébé qu’il a contribué à créer, que ses différentes inspirations bien différentes les unes des autres ont travaillée (différence qualitative des instants de création). Là je récite ce que je crois être la mort de l’auteur, ou ce qu’on m’en a dit que ça existe chez Barthes.
L’oeuvre surprendrait en soi, non seulement le spectateur, mais aussi l’artiste. Après pas dit que l’artiste jouisse de ce qu’il a produit. Que dit Barthes ?
S’il dit qu’il n’en jouit pas, c’est qu’il y a un écart entre ce que l’artiste voulait dire et ce qu’il produit, et donc une prétention de l’auteur à n’être pas mort, et condamné à produire une oeuvre (enfin là c’est une idée en passant).
b) Il s’oppose en tout cas à l’idée de l’œuvre géniale comme production imprévue (Kant, Critique de la faculté de juger) mais production :
– d’un homme lui-même génial
– qui peut faire école (et donc permettre la création d’œuvres qui ensuite produisent au moins du plaisir).
L’homme génial c’est pas pour Barthes. Pourtant le créateur des Sopranos me semble être de cet acabit (au moins par étincelle), il a su faire du nouveau derrière la culture de masse. On a là un sujet créateur qui n’est pas mort, mais qui était capable de faire du nouveau.
Et faire école, on dirait du Ricœur (mais peut-être en parlerai-je un jour).
Ainsi je me permets de rabattre la jouissance du côté de l’œuvre de génie, du sans-recette qui peut toutefois inspirer des recettes qui feront plaisir (imaginons le 1er roman policier, il est jouissif, qu’il soit de Conan Doyle, de Dostoïevski ou d’un autre).
T’en fais pas (ou fais-t’en beaucoup), je t’embête bientôt sur la suite de ton texte. Sinon, t’es pas obligée de répondre, moi je suis très heureux de parler tout seul.
18 janvier 2013 à 12:25 Oscar Gnouros[Citer] [Répondre]
Tiens, les robots spammeurs de blogs sont de plus en plus efficaces, et parviennent même à dire que les œuvres de gauche, comme Germinal, sont plus dans la jouissance que dans le plaisir. (oué, je peux faire mon troll aussi)
19 janvier 2013 à 22:39 Clémence[Citer] [Répondre]
Merci Muskette pour cet excellent article !
Comment s’empêcher de souligner ce passage : « Mais la réversion, c’est une percée de l’incertitude et du symbolique dans la détermination du réel : c’est de l’imaginaire bien sûr ! L’hédoniste, le philistin, le libertin ne sont ni des séducteurs ni des jouisseurs, car ils n’imaginent rien et ne laissent aucun doute sur leurs intentions : ils montrent, regardent, consomment, mais celui qui est séduit et qui jouit, c’est celui qui entre dans l’imaginaire des signes. Qui rêve et fantasme, qui ne cherche pas à découvrir une quelconque vérité mais accepte de se maintenir sur la faille, dans l’incertitude et le jeu infini des apparences. », où, sûrement aussi à force de parler plaisir et sensualité, j’ai hurlé au Vrai, au Beau, à la force argumentative bien menée. Si ça, ce n’est pas séduire les lecteurs de Morbleu!, qu’est-ce donc ?
Au sujet des remarques de Luccio :
1) « Quand je jouis d’un bon livre je me plais à être constamment surpris par des passages pourtant brillants et logiques » : ne nous ferais-tu pas l’esquisse d’une définition novatrice du principe de réalité, enfin positif ? Ce vent de fraîcheur dans le pessimisme hivernal ambiant et dans le fatalisme psychanalytique n’est pas sans apporter un baume à nos cœurs desséchés bien qu’enneigés par tous les terribles partisans du « c’était mieux hors du réel » et « nous sommes tous déterminés par l’alternance rêve/réalité ».
(cette remarque est gratuite, pardonnez de plus l’emportement dans le hors-sujet qui la caractérise)
2) cf.3) a) « S’il dit qu’il n’en jouit pas, c’est qu’il y a un écart entre ce que l’artiste voulait dire et ce qu’il produit, et donc une prétention de l’auteur à n’être pas mort, et condamné à produire une oeuvre (enfin là c’est une idée en passant). » J’attends également ton avis sur la question, Muskette, mais de manière tout à fait libre et personnelle, je dirais qu’il y a toujours écart entre ce que voulait dire et ce que dit finalement l’artiste. Comment pourrait-il en être autrement ?
22 janvier 2013 à 12:26 Muskette[Citer] [Répondre]
Bonjour Luccio et Clémence,
Vos réponses/remarques/questions m’enchantent, parce que je ne suis pas sûre d’avoir des réponses précises à donner, et que du coup ça ouvre plein de pistes.
Alors à peu près dans l’ordre :
• Luccio ton art du condensé m’épatera toujours.
Sinon, la jouissance est complètement du côté de la surprise, que celle-ci soit bonne ou mauvaise d’ailleurs. Et comme tu le soulignes les lectures inconfortables sont source de jouissance, parce qu’elles nous replacent toujours dans une position de sujet tenu hors du texte, à distance (difficulté, style, profondeur, etc.), qui nous permet de mieux les jauger dans leur entier, mais en même temps elles nous absorbent, nous fascinent, nous séduisent, et qu’on se trouve simultanément placé dans la position d’objet de l’auteur (qui nous balade, nous décontenance, nous agace, etc.). Elles nous font jongler entre sujet et objet, nous empêchant de totalement « nous oublier » dans l’œuvre (apathie, abrutissement) et de totalement la dominer.
Pour les Sopranos et Lautréamont j’avoue mon ignorance, même si je les regarde/lis je prendrai l’analyse que tu suggères comme guide.
• Luccio et Clémence :
Sur la mort de l’auteur, la jouissance de l’auteur et le génie, je ne sais pas trop ce que pense réellement Barthes. Il me semble qu’il n’exclut pas la possibilité pour l’auteur de jouir de son œuvre, en revanche je ne sais pas si c’est une réalité. Je dirai qu’il y a de toute façon, pour un auteur qui a produit une grande œuvre, une jouissance-souffrance qui est celle de l’artiste face à l’objet qu’il a créé et qui, de fait, lui échappe. Donner une œuvre au monde, c’est renoncer à l’améliorer, à la protéger, à la restreindre à une seule lecture ; c’est quitter le confort de la possession pour s’affronter à l’incompréhension, à l’interprétation, à la critique.
Pourquoi en revanche refuser le génie ? Je ne te suis pas, Luccio, sur l’idée que le génie pour Kant est une production imprévue ; il dit que le génie est un talent consistant à produire ce pour quoi aucune règle déterminée ne peut être indiquée, à donner de manière innée des règles nouvelles et originales à l’art. Je ne crois pas que le génie soit une fulgurance, un imprévu ou une épiphanie ; le génie peut tout à fait relever d’un travail long et acharné, d’un effort pour dépasser le simple plaisir (l’imitation chez Kant) pour créer une rupture dans les règles établies. L’auteur qui crée une œuvre de jouissance, en ce sens que je tire de Barthes (mais c’est mon interprétation, peut-être forcée), est un génie ; génie laborieux, insatisfait, inquiet, mais génie tout de même, car là où nous évoluons dans des habitus confortables de lecture, il offre une œuvre qui les brise, les remplace, les révolue.
À ce sujet, et pour le fun, Cavell définit dans Conditions nobles et ignobles, partie 1, et suite à Emerson le génie comme confiance en soi.
Or Emerson écrit, dans « Confiance en soi » : « Dans chaque œuvre de génie, nous reconnaissons nos propres pensées, que nous avons rejetées. Elles nous reviennent avec une certaine majesté née de l’aliénation ». On retrouve ici l’idée d’écart que tu soulignais entre ce que l’auteur voulait dire et ce qu’il a produit : il y a toujours un écart, car l’écriture révèle des pensées que nous avons refoulées (sur le modèle du transfert freudien, souligne Cavell). Je suis d’accord avec Clémence sur ce point, on pourrait même pousser un cran plus loin et dire que l’auteur qui a réussi à dire exactement ce qu’il voulait dire, a produit au mieux une œuvre de plaisir, au pire une platitude. Comme pour tout effort de la pensée, c’est seulement quand on lutte, quand on éprouve l’insatisfaction et la brisure que l’on parvient à produire quelque chose qui en vaut la peine.
Cavell va même plus loin : cette « majesté aliénée » dont parle Emerson, il la considère comme une transcription du sublime kantien… Il y a du génie, il y a du sublime, il y a de la jouissance du côté de l’auteur, parce qu’il se révèle à lui-même à travers l’épreuve de l’écriture.
D’ailleurs, mais là je commence à dériver, quelques lignes plus loin Cavell raccroche tout ceci à l’idée de séduction, qui nous détourne de nos habitudes, de la société, de la conformité, qui conduit à une aversion pour les normes et à une conversion vers le développement du moi. Et tout cela passe par la figure de l’ami… C’est pas top, ça ? ^^
22 janvier 2013 à 21:45 Luccio[Citer] [Répondre]
Pas mal le truc sur le sujet et l’objet (intéressant en soi et efficacement résumé). C’est vraiment super vraiment super pour de vrai (en plus c’est assez simple, du coup c’est encore plus super).
Ca me fait penser aux Idées esthétiques définies par Kant (Critique de la faculté de juger, §49) : c’est quand un truc imaginé ne peut être totalement appréhendées par la pensée, et donne ainsi toujours à penser.
Pas mal aussi le reste (même si c’est bizarre d’avoir une aversion pour les normes quand on veut se développer, « aversion » c’est fort). Et quel déconneur de Cavell, c’est bien le fun. Mais les pensées aliénées, c’est celle de l’auteur sur sa feuille ou celles que le lecteur formule par l’intermédiaire de l’auteur ? Si c’est le numéro 1, ben le Cavell-Emerson il se prend pas pour de la merde)
Sur le génie, il me semble que Kant utilise une image biologique, il en parle comme d’une nouvelle espèce (qui produit des œuvres : un nouvel arbre qui donne de nouveaux fruits).
L’arbre il travaille à produire ses fruits, mais quand les autres arbres le regardent, eh bien pour eux il produit quelque chose d’absolument nouveau, d’imprévu, qui ne se laisse réduire à aucune règle connue (et peut à la limite en inspirer à l’imitateur).
Mais le génie, qui produit des Idées esthétique, au fond je m’en fous un peu ; à titre personnel je préfère les Idées esthétiques, qui pourraient bien naître par hasard, ou collectivement. Cela aussi parce que pour l’instant j’ai pas pondu beaucoup d’œuvres de génie, et que je suis plus spectateur des Idées esthétiques que contemporain d’un génie (« Oui, oui, à par toi Oscar »). (Et là on pourrait recaser « Les Sopranos », où y’a un génie mais pas tout seul, dans le collectif — ce qui suppose que ses collaborateurs le comprennent).
En tout cas, le génie, dans l’histoire, il fait figure de fulgurance, d’imprévu, etc. (voir ce que peut en dire Nietzsche dans la deuxième de ses Considérations inactuelles, et aussi quand il parle notamment des « effets en soi », irréductibles à toute explication).
Pour l’essentiel le Génie me semble être une idée qui signifie qu’un auteur donne de sa substance à lui à ses œuvres (et même de son inconscient, révélé dans l’écriture — voir Cavell tout ça) ; or il me semble que ce soit pas hyper « mort de l’auteur » comme concept.
Mais je viens de comprendre ta réponse. Et je pars de loin (et n’avais pas compris la mort de l’auteur).
En fait ce que Barthes entendrait par la mort de l’auteur, ce serait la fin de la prétention de l’auteur à comprendre son œuvre mieux que les autres, l’acceptation qu’elle appartient aux autres (d’où la possibilité d’en être insatisfait, ou d’être surpris par elle). Du coup le génie pourrait tout à fait être conservé dans ce schéma : le bonhomme il bosse et réfléchit, mais lui-même est incapable de trouver les règles précises de l’élaboration de ses petits machins.
Du coup le Génie serait le symbole de la mort de l’auteur (ce prétendu maître incontesté du sens de ce qu’il produit) ; du coup tu peux le garder avec Barthes.
Et tenté je suis, de dire qu’il donne de sa substance, mais selon une modalité qui lui échappe, avec tes Emerson-Cavell s’il le faut (avec les pensées couchées sur le papier, etc. En fait ça doit d’ailleurs surtout être toi qui est tentée (moi là je le redis : Kant a déjà tout dit).
Mais tu fais quoi de la production artistique de masse. Le Cinéma y’a des trucs sympas, même Autant en emporte le vent… des trucs d’années où y’a pas 1 réalisateur pour 1 œuvre, mais un tas de scénaristes, producteurs et acteurs maison, et Bam ! Casablanca quand même.
(c’est l’opposé de ce que j’avançais avant pour défendre Les Sopranos, mais c’est que je suis un sophiste) (de même je ne connais rien de la réalité de la production et de la réalisation de Casablanca).
C’est une question plus qu’un défi.
Putaing ! [paragraphe rédigé avant ceux qui le précèdent mais que je laisse pour mémoire] si c’était pas sans doute déjà fait, si c’était un peu intéressant, et si j’en avais les compétences, eh bien je proposerait un article sur la façon dont Barthes et la mort de l’auteur permet de penser non plus des Génies — « effets en soi », mais des Idées esthétiques – œuvres – « effets en soi » : plus fort que Nietzsche, Barthes ! (et Alain, qui rappelle que l’Idée se réalise au fur et à mesure de l’œuvre, qu’elle est un peu extérieur à l’artiste). Ca s’appellerait « le platonisme post-nietzschéen de Roland Barthes ».
[je garde quand même l’idée que Barthes doit davantage d’intéresser aux Idées esthétiques, aux choses dont on jouit, qu’ celui qui les produit]
Je pourrais peut-être même le tenter sans Barthes, par amour de la vérité, ce serait si romantique !
(je serais désolé de ce paragraphe si je n’étais pas persuadé que le lecteur de passage saute ce genre de moments en disant « là il s’écoute parler, il dit n’importe quoi »).
Ainsi je peux conclure, en deux points :
– tout d’abord me préciserais-tu la référence des textes de Barthes. (Ah, c’est écrit, Le plaisir du texte, c’est long ?)
– un jour je lirai à fond la deuxième partie de ton texte : tremble !
25 janvier 2013 à 17:12 Muskette[Citer] [Répondre]
Pour la référence c’est bien Le plaisir du texte, c’est très court (90 pages écrites en assez gros), moi je l’ai dans l’édition Points Essais.
Et je crois qu’Emerson et Cavell parlent bien des idées aliénées de l’auteur (qui apparaissent comme des révélations subites, après relecture de soi).
Mea culpa pour le génie, j’ai interprété ton usage du terme « imprévu » en un sens temporel assez peu légitime (comme un équivalent d’instantané), mais l’imprévu reste compatible avec un travail de longue haleine en amont.
Intéressant le truc sur les idées esthétiques, peut-être peuvent-elles être produites à plusieurs mains… Mais alors là je n’ai aucune idée de la manière dont on peut penser une oeuvre de génie collective, il faudrait une sorte de transcendance esthétique unifiant les divers éléments produits ; en tout cas si tu as des outils ce serait une analyse à mener!