« C’était justifié »
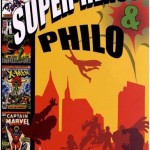 MacGyver était mon héros. Sa coupe de cheveux dans le vent, son aplomb inébranlable et, bien sûr, sa capacité à s’extraire de hangars piégés à la dynamite grâce à un bout de ressort et un peu de sel m’avaient conduite à envisager pour lui et moi des épousailles prochaines (ça, c’était juste avant que je voies un clip de Roc Voisine et que je ne reconsidère mes projets maritaux en faveur d’un brun). Mais ce qui faisait la grandeur de MacGyver, c’était qu’il rencontrait les pires méchants, se sortait des pires situations, voyaient les pires salauds zigouiller des innocents ou polluer des contrées protégées, sans jamais se départir de sa bonne humeur et de blagounettes bien envoyées. D’aucuns me rétorqueront que je ne suis qu’une fille, et que si j’avais des corones j’aurais regardé Starsky et Hutch ou L’Agence tous risques. Mais là encore, ça marche ; car tous nos héros des années 80 et 90 avaient de l’humour, des dents blanches et un sens de la répartie qui laissaient les horreurs de ce monde leur glisser sur la moustache comme l’eau sur un canard.
MacGyver était mon héros. Sa coupe de cheveux dans le vent, son aplomb inébranlable et, bien sûr, sa capacité à s’extraire de hangars piégés à la dynamite grâce à un bout de ressort et un peu de sel m’avaient conduite à envisager pour lui et moi des épousailles prochaines (ça, c’était juste avant que je voies un clip de Roc Voisine et que je ne reconsidère mes projets maritaux en faveur d’un brun). Mais ce qui faisait la grandeur de MacGyver, c’était qu’il rencontrait les pires méchants, se sortait des pires situations, voyaient les pires salauds zigouiller des innocents ou polluer des contrées protégées, sans jamais se départir de sa bonne humeur et de blagounettes bien envoyées. D’aucuns me rétorqueront que je ne suis qu’une fille, et que si j’avais des corones j’aurais regardé Starsky et Hutch ou L’Agence tous risques. Mais là encore, ça marche ; car tous nos héros des années 80 et 90 avaient de l’humour, des dents blanches et un sens de la répartie qui laissaient les horreurs de ce monde leur glisser sur la moustache comme l’eau sur un canard.
Ces héros pouvaient justifier toutes leurs actions par un sens aigu du bien et du mal, par une loyauté implacable envers leurs proches, par le rejet systématique du mensonge sous toutes ses formes et par un recours à la violence modérée – ou du moins, ludique. Ils avaient également des amis fidèles, qui se seraient coupé un bras pour eux, et ils faisaient du charme aux filles, pleins de vigueur qu’ils étaient. Ils étaient donc d’autant plus justifiés dans leurs actions que de braves gens les soutenaient entièrement et que les filles n’avaient pas peur d’eux. La justice était leur impératif catégorique, la drôlerie et la vérité leurs maximes, le bien leur idéal anhypothétique.
Or, depuis une dizaine d’années nous n’avons plus les mêmes héros de série télé. Nous avons plutôt, et cela a déjà été bien rebattu, des anti-héros. Ils restent inscrits, même en négatif, dans la sphère des héros parce qu’ils conservent une certaine aisance pratique et un sens de la répartie ; mais ils sont devenus plus vieux, parfois handicapés, toujours aigris et asociaux, souvent cruels et froids, atteints de TOC et de névroses plus ou moins sévères. Il y a même parmi eux des tueurs en série, et, pire encore… des menteurs ! [1] Alors suffit-il de savoir manier un revolver ou un scalpel pour être un héros ? Qu’est-ce qui justifie encore les comportements immoraux de nos héros postmodernes ?
Car étrangement, plus un anti-héros pousse loin la méchanceté, le mensonge ou la violence, plus on l’aime. Le cynisme et la sociopathie séduisent. Et séduire, c’est conduire hors du droit chemin, hors de la rectitude, hors de la voie commune. MacGyver détournait les mineurs comme moi, sans difficulté ; Dexter détourne les adultes bien-pensants et plonge les mères de famille respectables dans des fantasmes de couteau et de sang qui aspergent les vitres. Starsky et Hutch faisaient rêver tous les garçons avec leur Gran Torino de ouf et leur amitié à la vie à la mort ; Dr House a bien une moto mais pas d’amis, ou plutôt il a des disciples souffrant de complexes d’infériorité carabinés. Les gars de l’Agence tous risques se sont évadés parce qu’ils étaient innocents, mais ont décidé de venir en aide à tous ceux que la société ou les malfrats condamnent injustement ; Michael Scofield [2] fait évader sa grosse brute innocente de frangin, mais c’est dans l’espoir d’aller se siffler des mojitos tous les deux comme des rats au Mexique, et tout ça en laissant filer en même temps qu’eux des psychopathes patentés [3].
Autrement dit, la justification morale postmoderne n’a plus pour référence le Bien, le juste ou le vrai ; elle aurait alors pour source et pour finalité, dans une circularité qui semble dénuée de tout progrès dialectique, la jouissance du spectateur. Jouissance de voir quelqu’un de plus malheureux que soi s’en sortir, comme une promesse de lendemains qui chantent pour dépressifs avertis ; jouissance d’avoir dépassé la bienséance de la pensée moralisante bourgeoise pour, enfin, retrouver du mordant ; jouissance cathartique, enfin, de faire souffrir ceux qui le méritent, mais dans une logique de vengeance dont ils ne sont même pas avertis [4]. La justification n’est plus morale ; elle est aussi physiologique que devaient sans doute l’être les jeux du cirque ou la tragédie grecque. Les héros TV qui parviennent tant bien que mal à distinguer encore entre justice et vengeance ne semblent plus tirer de satisfaction à coffrer les fous et les assassins ; car ce n’est pas leur action que l’on savoure, c’est des meurtres et tortures montrés avant que l’on se repaît. Ils restent donc là, mâchoires crispées et front ombrageux, à attendre le prochain épisode, puisqu’il va de soi que tant que le spectateur voudra du sang, leur quête de justice restera asymptotique.
Nos anti-héros, froids et dénués d’émotions qu’ils sont, seraient-ils le reflet du cynisme de notre époque ? Le symptôme de sociétés désincarnées, où l’intello n’a pas le droit d’être, en plus d’intelligent, aimable ? Où il faut être plus rusé que l’autre, parce que l’on ne peut jamais l’emporter dans un face-à-face loyal, que l’ennemi soit la maladie, le criminel ou le mensonge ? Peut-être. Néanmoins il me semble faux de dire qu’il n’y a plus de morale dans les pérégrinations de nos anti-héros. Plutôt, et c’est bien connu, il n’y a plus de morale mais des éthiques.
Le héros définit ce que doit être la justification morale, il justifie les moyens par la fin, il se fait la mesure du bien et du mal. Comme ce cow-boy [5] qui ne cesse de répéter « c’était justifié », faisant allusion au malfrat qu’il a descendu au début de la série. Mais pourquoi était-ce justifié ? Parce qu’il l’avait prévenu de déguerpir avant 24h, et que le délai écoulé, il a trouvé le méchant en train de manger du homard tranquillement dans un restaurant huppé de la ville ? Parce que celui-ci a, à un moment, voulu sortir son flingue et qu’il s’agissait donc uniquement de légitime défense ? Parce que le méchant aurait, vivant, continué à nuire à la société ? Peut-être tout cela à la fois, peut-être aucune de ces réponses. Je crois que c’était justifié parce que le héros donne l’impression d’être pote avec les méchants, parce qu’il blague avec eux, parce qu’il les avertit de ce qui va leur arriver s’ils ne se rangent pas, parce qu’il est fraternel. Ici commence à se dessiner la possibilité d’une dialectique, finalement. Car le fil rouge entre toutes ces séries, tous ces héros et anti-héros, toutes ces années et ces époques différentes, c’est que les rôles se confondent. Qu’il n’y a plus de démarcation nette entre le gentil et le méchant, que le « héros » comprend un peu trop bien les tarés qu’il traque, soigne ou côtoie, qu’il est tout sauf pur et que c’est pour ça qu’il gagne au bout du compte. Le mal s’est intensifié en termes qualitatifs, mais, d’un point de vue quantitatif, il s’est tellement dispersé qu’on ne peut le reconnaître que s’il nous est familier. Le héros reconnaît dans sa chair les remugles des mauvaises intentions et de la violence, et il en joue. Ainsi il devient non plus un objet d’admiration, mais un objet de désir, avec toutes les contradictions et les fantasmes que cela peut impliquer.
Oh, il arrive bien encore, dans certains épisodes, que le « gentil » regarde à la fin le méchant avec dans le regard du dégoût et le traite de monstre ; on retrouve alors une justification morale traditionnelle, où la condamnation ferme, sans appel, rappelle où se trouve le seuil des bonnes mœurs. Mais le reste du temps, nous jouissons de ces anti-héros parce qu’ils n’ont d’autre justification que l’étrange slow qu’ils dansent avec le mal ; ils sont justifiés dans leurs actions, simplement parce qu’ils se frottent à l’altérité [6] et parce qu’ils l’abordent sans détour. Ils flirtent avec l’ennemi, le connaissent, le reconnaissent. Leurs actes sont justifiés, parce qu’à chaque confrontation à Autrui dans ce qu’il a de plus étrange, ils acceptent pleinement sa présence, ils le voient véritablement et lui parlent ; et que dans cette fraternisation toujours dérangeante, souvent immorale, se joue quelque chose comme une redéfinition de l’homo ethicus. Un homme éthique qui se promène certes hors des clous et menace toujours de confondre le bien avec l’utile ou l’agréable, mais qui sous son incapacité à communiquer normalement et à avoir une vie sociale équilibrée, fait preuve, bizarrement, d’une sorte de charité nouvelle envers ses frères humains. Il s’agit donc non plus d’une morale traditionnelle, mais de moralité subjective ; non plus de normes sociales, mais d’une éthique fondée sur un moi tourné vers l’extériorité. Là réside une justification éthique nouvelle : celle du mérite, ou peut-être plutôt de la bonté, à être en relation non plus avec nos semblables, mais avec les plus étrangers des êtres humains – les malades, les pervers, les criminels [7].
Et si ces héros éthiques étaient en plus aimables, proches de leurs congénères et gentils, alors ce seraient des saints ; il faut donc les dépouiller de toute sociabilité pour les rendre à leur fonction essentielle, et les maintenir dans une insociabilité suffisamment raffinée pour que ni nous ne nous confondions avec eux, ni nous ne les rejetions entièrement. Ces anti-héros deviennent pour nous, spectateur, à leur tour la figure d’Autrui : si proches de nous, et pourtant si étranges et menaçants, que nous ne savons plus trop si nous avons ne serait-ce que le droit de les aimer. Mais nous entrons dans la danse et, protégés par la fiction, nous soumettons à l’épreuve de ces Autres [8] nos certitudes morales et notre charité – à défaut de parvenir à les soumettre à des autruis en chair et en os. Car s’ils remplissent certes une fonction cathartique, ils nous procurent tout de même plus de gêne que de soulagement ; c’est dans cette gêne que se construit la jouissance du spectateur, dans cette perception plus aiguë des limites qu’ils transgressent allègrement et que nous pouvons ainsi mieux redéfinir et réfléchir.
________________________
[1] Petit soubresaut kantien.
[2] Prison Break, de Paul Scheuring, 2005
[3] Il n’a ensuite de cesse de vouloir réparer ses fautes, mais cette obsession est plus névrotique que morale.
[4] Derek Morgan, Esprits criminels, S6*14 : « La chasse n’est pas un sport. Dans un sport les deux camps doivent savoir qu’ils participent au jeu. Paul Rodriguez »
[5] Raylan Givens, dans Justified, de Graham Yost, 2010.
[6] Petit (très) condensé de la thèse de Levinas : pour Levinas, qui a subi de plein fouet la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, la morale traditionnelle a échoué parce qu’elle a toujours été pensée à partir d’une opposition entre le Même et l’Autre, entre soi et autrui. Pour reconstruire une éthique reconnaissant pleinement la fragilité d’Autrui et la responsabilité que nous avons envers lui, il faut comprendre qu’elle n’apparaît que lorsqu’on sort du Même pour se tourner vers l’Autre, lorsqu’on répond à l’appel d’autrui par-delà tout conflit et toute opposition, lorsqu’on entre en relation avec lui – par le langage. Ce mouvement est avant tout un désir et une bonté ; et il nous ouvre à une transcendance, celle de l’Infini (ou de Dieu).
[7] On est bien d’accord : un malade n’a rien de commun avec un criminel ou un « monstre » ; mais dès lors qu’on le définit comme « un malade », on n’est plus tout à fait face au même que nous.
[8] Dans Lost, les héros – qui sont d’ailleurs tous des anti-héros – sont confrontés à des ennemis terribles : les Autres…
| Pour approfondir, ce produit disponible chez un libraire de proximité, éthique, responsable, durable et équitable : |

15 septembre 2012 à 10:26 Luccio[Citer] [Répondre]
Cher Muskette,que la bienvenue aille sur ta demeure. Je te promets de te sortir un commentaire un peu correct à ce texte, que tu ne connaisses pas trop la solitude des textes non commentés (pour éviter ça la première fois je parlais d’Israël etc.). Donne-moi quelques jours pour rassembler mes idées.
Allez, juste une question-remarque en passant : l’anti-héros c’est plus Gaston Lagaffe, à qui rien n’arrive du héros ordinaire, mais House ou Dexter, des mecs qui ne sauraient être des héros mais à qui il arrive des trucs pas communs. C’est ça ?
15 septembre 2012 à 12:49 Clémence[Citer] [Répondre]
Excellent article !
15 septembre 2012 à 21:37 Luccio[Citer] [Répondre]
Autre compliment : j’aime beaucoup le « soubresaut kantien » de la note 1.
Sinon ton analyse est très intéressante. Mais il ne faut pas oublier que la TV américaine fournit nombre de héros divers, donc de possibles contre-exemples. L’un deux est l’agent Gibbs de NCIS, ainsi que « ses hommes », qui sont tels les Mc Gyver de ta jeunesse. Il faut dire que le producteur est le somptueux Bellisario, créateur de Code Quantum, et du grand oublié de ta série des héros de ta jeunesse : l’illustrissime Thomas Magnum !
Sinon ta thèse est forte et bien menée. Mais peut-être que ces héros qui ne sauraient être des saints surtout parce qu’ils sont là pour détendre ; l’affaire ne serait alors pas (seulement) éthique, mais simplement (/aussi) divertissante : le monde est compliqué, celui qui le gère ne doit pas être en plus capable de se gérer lui-même. Je pense à House, grand manipulateur, mais malheureux comme les pierres de ne pouvoir se défendre de ses excès (ça marche aussi pour Dexter). Dès lors ils seraient aussi là pour rassurer : mesdames et messieurs, vous n’êtes peut-être pas talentueux, mais au moins vous n’êtes pas malheureux.
Enfin en écrivant ces quelques lignes, je suis loin de dire qqch contre ton propos ; je ne sais même pas si je le complète. Et ton analyse psychologico-philosophico-morale m’apparaît d’autant plus fine.
J’en profite pour te dire que le mal qui est plus intense c’est bien vu. En effet dans les séries à la Mc Gyver, si les salopards sont parfois bien des salopards, ils sont rarement retords. Faut dire qu’on n’a pas le temps en 40 minutes — thèse expresse : améliorer le rapport au bien et le mal doit passer par le personnage principal , car un épisode ne suffit pas ! — corolaire : les Sopranos montrent ce rapport avec un(des) méchant(s).
PS: (issu d’un brouillon passé) : Sinon (le 3ème « Sinon », de quoi faire un élevage) je crois que les Experts échappent un peu à ton analyse car ils ont un côté très raison froide et science technophile. L’anti-héros de ton schéma est un héros qui semble réunir le héros et son double maléfique. D’habitude les deux sont séparés (Batman et Joker, Holmes et Moriarty), eh bien lui il est obligé d’incarner les deux et ne peut avoir la classe – car House n’a pas d’ennemi, il est lui-même malade (physiquement, mentalement, socialement (si ça existe)). Mais je vais maintenant arrêter de t’embêter
PPS : Bonjour Clémence !
(chez Morbleu on kiffe les lecteurs fidèles qui n’hésitent pas à mettre des commentaires — du moins j’imagine, peut-être Oscar daignera-t-il confirmer)
16 septembre 2012 à 8:02 Clémence[Citer] [Répondre]
(Salut Luccio ! Il faut dire que vous savez y faire, pour que vos lecteurs restent dans le coin ! Quel site agréable !) (Ce bonjour est entre parenthèses, mais ce n’est pas pour en amoindrir son importance ou celle de son destinataire, c’est simplement parce qu’il s’inscrit à part des commentaires portant proprement sur le post)
Pour le « soubresaut kantien », il m’a fait bien rire aussi. J’ai imaginé un instant tes mains prises d’un accès de nervosité, les doigts raides et leurs mouvements violents, rapides et désorganisés, l’encre de ton stylo éclaboussant les murs ou les touches de ton clavier malmenées au point de rester enfoncées de travers. KANT INSIDE.
16 septembre 2012 à 18:05 Muskette[Citer] [Répondre]
Merci pour vos commentaires! Et pardon pour la longueur de la réponse.
Mea culpa pour Magnum, j’y ai pourtant pensé (l’allusion à la moustache) mais j’ai oublié de le citer!
Pour la question des héros/anti-héros : je dirais que les personnages comiques comme Lagaffe n’entrent même pas dans cette distinction, car ils restent toujours insérés dans un quotidien banal et que nous tous partageons (ou pourrions partager). Ils n’ont pas de talent particulier, de pouvoir spécifique ou un caractère admirable, et ils n’ont pas de quête (ce serait peut-être un filon à exploiter, cette idée de quête… Même les anti-héros n’en ont-ils pas une? La quête de soi, de la rédemption, de la normalité, là où elle était auparavant quête de justice, de vérité, d’équité? La quête se serait alors intériorisée et centrée sur le moi, mais elle demeure néanmoins). Il faudrait un autre mot pour désigner ces personnages principaux… Mais je ne sais pas lequel.
Dexter et House pourraient être des héros ; ils en sont à leur manière. Mais ils se placent eux-mêmes en dehors des limites traditionnelles qui définissaient la sphère du héros : moralité, bonté, justice. Ce sont ainsi – à mon sens – des anti-héros, des héros en négatif, ceux du côté obscur de la force.
Bien sûr qu’ils sont là pour divertir, et que la motivation n’est pas la 1e des producteurs et scénaristes. J’ai plutôt considéré ces séries comme le reflet de l’âme du siècle, comme un miroir de l’état moral de nos sociétés actuelles.
Bien vu pour l’incapacité à se gérer soi-même Luccio! Ce paramètre trouve vraiment sa place dans l’analyse, il manquait même. Effectivement ces anti-héros seraient les symptômes de sociétés où l’individualisme et les fractures sociales rendent la charge de soi d’autant plus difficile que le quotidien offre bien peu de ressources ou d’espoir.
Pour les références contradictoires:
– je dois avouer que je n’aime pas du tout NCIS, pour beaucoup de raisons totalement subjectives.
– c’est vrai que NCIS, les Experts ou même Bones présentent des enquêteurs qui visent le juste, le bien, la vérité et ne fricotent jamais avec l’ennemi. Mais ils souffrent en revanche tous d’un même symptôme, qui me semble révélateur de cette tendance à dissoudre le héros traditionnel dans l’acide de la réalité sociale et culturelle occidentale : ils sont froids, insensibles, psychorigides et usent d’un humour morbide ou incompréhensible. Résultat : ils passent aux yeux de tous soit pour des extra-terrestres, soit pour des constipés (mais peut-être que je me trompe pour NCIS?). Eux aussi sont malades, quoique d’une autre manière que House. Ils seraient donc, si ma suggestion d’en haut fonctionne, à la limite entre héros traditionnel (quête du bien etc.) et anti-héros (quête de soi et insociabilité). Ou peut-être plutôt, ils formeraient une sous-catégories de héros : ceux qui refusent le mal sous toutes ses formes, mais ne parviennent à lui opposer le bien et le juste que sous des formes creuses, purement formelles, aseptisées et hygiéniques, comme s’ils n’y croyaient pas vraiment. Entre un mal trop réel, et un bien qui est sans cesse vidé par lui, bafoué, moqué, ces héros post-modernes sont menacés par la dépression ou la folie. Alors, sont-ils encore de héros, ou non? Là, je sèche…
16 septembre 2012 à 20:53 Luccio[Citer] [Répondre]
Ben dis donc… (je suis un peu saoul).
En effet l’état du siècle est compatible avec la nécessité du divertissement, vu que le succès du divertissement demande tout de même qu’il corresponde à quelque chose.
Reste à savoir si cela se retrouve dans nos comportements. Bon déjà ça se retrouve dans le rapport à ces héros, mais il faudrait voir dans quelle mesure c’est un rapport étroit (ce que suggère ton affaire de fantasme). Reste à voir dans quelle mesure ce truc éthique se retrouve dans d’autres domaines (ce que tu suggères, et dont je crois on n’a pas à parler avec précision ici, puisque ton texte a un objet précis et qu’on n’a pas à parler de tout et son contraire, ma bonne dame !)
Enfin, et c’est là le plus important : je m’en veux, mais je m’en veux ! de ne pas avoir su saisir l’allusion à Magnum ! On se croit parfois plus sagace qu’on ne l’est réellement.
Signature !
PS : Kant a-t-il défoncé les touches de ton clavier ?
16 septembre 2012 à 21:39 Muskette[Citer] [Répondre]
Tout à fait, ne mélangeons pas les choux et les carottes!
Mon clavier va bien, les convulsions se sont calmées ; il faut dire que je ne suis pas si convaincue que cela par la condamnation kantienne du mensonge, même si la place d’honneur qu’il occupe parfois ne laisse pas d’être troublante.
Bonne soirée à tous
Muskette
18 septembre 2012 à 17:43 Gnouros[Citer] [Répondre]
À mon tour de souhaiter la bienvenue à Muskette, nouvelle contributrice à Morbleu !, contributrice de qualité, comme on peut en juger à ce premier billet. Oui.
Néanmoins, je m’interroge par rapport à la noirceur des héros contemporains, qui trancherait avec la relative excellence morale des héros d’antan (si je résume bien). Car en effet, je me souviens de séries telles que, par exemple Dallas, où, hormis le bon Bobby (et encore), la plupart des protagonistes sont caractérisés par quelque chose de pas clair. De même, je pense, pour Les Feux de l’amour qui furent allumés dès les années 1970 (même si je connais moins bien, faudrait demander à Luccio). Dragnet dans les années 50, pour le peu que je m’en souvienne, faisait aussi intervenir des héros pas clairs. Plus généralement, le film noir américain avait ceci de caractéristique dans sa structure narrative qu’il faisait intervenir un héros torturé, en attribuant bien souvent son anormalité aux conséquences de la guerre (cf. par exemple Franck Sinatra dans Suddenly). D’où ma turpitude : est-ce si sûr que ce fait soit uniquement une caractéristique de notre temps ?
18 septembre 2012 à 20:15 Luccio[Citer] [Répondre]
Purée, je te reprocherais bien d’avoir éventé le sexe (ou le genre) de Muskette, alors que j’avais fait gaffe… mais en relisant je crois qu’elle le fait elle-même dans le premier paragraphe.
20 septembre 2012 à 15:26 Muskette[Citer] [Répondre]
Je suis embêtée d’avoir laissé entendre que la noirceur des héros est une totale nouveauté, mais je reconnais que ma présentation est un peu trop manichéenne. Mon enthousiasme m’a emportée hors des sentiers de ma prudence habituelle.
Bien sûr que cette noirceur a toujours alimenté beaucoup de fictions en tous genres, du roman au cinéma en passant par la BD, et bien sûr que, « dans le temps », tous les héros n’étaient pas des saints. Mais il me semble (et c’est peut-être une illusion ou un raccourci, voire une généralisation abusive?) que depuis une décennie ils sont presque devenus une norme. J’ai trouvé étrange qu’autant de séries TV proposent ce type de figure, et qu’on soit entré dans ce qui pourrait s’apparenter à une surenchère dans le cynisme et l’insociabilité, dans la froideur technique et le détachement vis-à-vis d’autrui (des autruis comme vous et moi). Comme si le héros type Magnum (pour toi Luccio) était has been, et que pour rester un héros il devait presque impérativement devenir un anti-héros. Ou alors se tourner vers la comédie.
Pourquoi cette survalorisation d’anti-héros? Parce que cela marche, fait vendre, séduit le public. Pourquoi? Qu’est-ce que ces anti-héros apportent qu’un héros gentil ne peut donner? En quoi sont-ils tout de même des sortes de héros? Là était ma question de fond. On pourrait sans doute trouver une généalogie beaucoup plus riche que ce que j’en ai proposé, mais disons qu’il m’a été plus facile de traiter cette question en m’appuyant sur le condensé que la télé nous offre actuellement.
22 septembre 2012 à 16:49 Dédé La Rana[Citer] [Répondre]
Evidemment le film noir, mais lui-même influencé par …
Oscar, tu dis que le cynisme où le caractère désabusé du héros est dû à la guerre; à l’origine du film noir, il est surtout dû à la laideur de la société, laideur esthétique de la grande ville et surtout laideur morale…
Elements critiques bien sûr effacés dans les séries d’aujourd’hui, qui sont là pour faire manger des chips à des connards
C’est sûr qu’ à côté de Max Guyver; Dr House a une profondeur psychologique abyssale… qui excite beaucoup les journalistes, alors que tout ça n’a pas grand intérêt
Dr House, vaguement inspiré du film noir pour bâtir le personnage central, mais visuellement un truc bien con qui sent le savon, le corps de l’agonisant n’y sent jamais la merde ou la mort
22 septembre 2012 à 17:02 Dédé La Rana[Citer] [Répondre]
A l’origine le héros (grec donc) n’était pas comme les dieux un idéal de bonté et de justice.
ces séries comme l’âme du siècle…
l’âme du 18ème siècle n’est donc pas chez Voltaire mais dans les contes populaires oraux que se racontaient les paysans
c’est juger d’un vin en goûtant sa lie
23 septembre 2012 à 21:24 Luccio[Citer] [Répondre]
Dr House c’est surtout Sherlock Holmes sans les cadavres. Du coup y’a plus le crime international, et du coup il est un brin plus névrosé car il a moins à s’occuper.